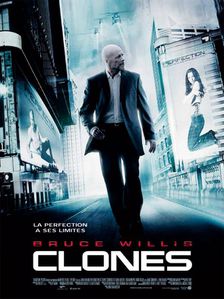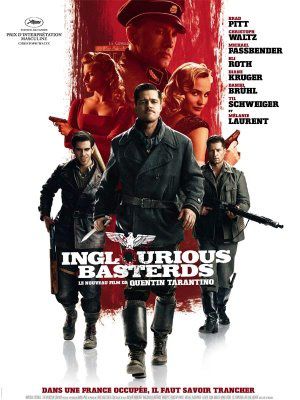Chaque année, il y a des films injustement boudés, méprisés ou tout simplement ignorés par le public. Si cette indifférence a souvent un lien avec la qualité intrinsèque du film, la notoriété d'un film repose malheureusement sur la communication journalistique.
Mr. Nobody fait partie de ces films qui essuient la vindicte de l'aréopage des journaleux, subissent l'ostracisme injuste des "docteurs es cinéma" de la critique. On se demande parfois si nos chers "professionnels" du je-m'assis-pour-regarder-un-film sont encore du côté de l'art -
tout entier - du cinéma.
A force de les lire, on comprend qu'ils ont une logique d'encensement et de mépris qui reposent avant tout sur un paradigme du cinéma (pour reprendre la notion de Thomas Kuhn) fondé non pas sur la recherche de l'innovation mais sur des préjugés et des réseaux.
Schématiquement, on pourrait résumer leur modèle de pensée en 4 points :
1. Le cinéma-sujet, restreint à une production limitée qui traite d'un thème bobo sur les problèmes de couple, d'adolescence, de pauvreté ouvrière ou d'intégration nationale, sans implication de l'auteur dans la mise en scène comme dans le sujet est LE vrai cinéma. Le cinéma moderne, quoi, celui qui n'est pas construit, qui dit le vrai, montre
la réalité (sic) à la bourgeoisie qui aime se rassurer de son bien-être devant l'étendue des problèmes du monde. De la complaisance polie en somme.
2. L'auto-congratulation du cinéma des copains ou de ceux qui ont déjà une réputation monolithique et qu'il convient de récompenser. Peu importe si ces cinéastes n'inventent plus rien ou régressent sur plusieurs points, ils bénéficient de la couverture assurance-presse qui va avec.
3. Le cinéma-artifice, fait de ce qu'ils pourraient appeler "fioritures", à la mise en scène intentionnellement démonstrative et cohérente avec le propos développé par l'auteur est LE mal. C'est le cinéma américain dans sa très large majorité qui n'a pas peur d'abuser du langage du cinéma, celui de l'image et du son, avant même de celui de la littérature.
4. Et puis, il y a des petits cinéastes qui développent un style mais tentent avec audace, quelque chose de différent, quitte à se ranger parfois du côté du cinéma "fabriqué" américain. Ils sont rares, mais souvent courageux parce qu'ils ont des grandes intentions - parfois brouillonnes - mais des moyens relativement modestes. Malheureusement pour ceux là, il faut choisir son camp, et ne pas regarder du côté de la catégorie 3. On ne peut pas être un auteur et un formaliste. La réalité du monde ne peut s'entâcher d'un parti-pris esthétique et d'un propos ambitieux.
Et voilà que Jaco Van Dormael a le mauvais goût de se retrouver dans la catégorie maudite. Celui qui est responsable d'un film bien français sur le problème de la maladie mentale (
Le huitième jour) a eu le malheur de vouloir parler d'universalité et d'abstraction physique sur le monde et les humains, avec des stars internationales, le tout en anglais. Aïe.
Mais quelle mouche a piqué le cinéaste belge pour avoir cette envie subite de film amerloc, avec du futur, des gros buildings, des vaisseaux, de la planète Mars et des ados qui s'aiment ? Les journalistes s'interrogent encore sur cette idée saugrenue qui mêle les sentiments humains, le temps et le questionnement métaphysique, avec des sous et des images léchées. Quand on est un cinéaste respectée de catégorie 1, on aborde ces questions de manière "réaliste", dans l'univers d'une chambre d'appartement, avec des gens inconnus et mal habillés. Bah oui, la "vraie vie" (sic) ça se cueille, dans sa totalité, et ça se passe de réflexion, d'interprétation sur la manière dont on y accède. C'est presque de l'incongruité, Jaco. Alors vous vous ferez pardonner en regardant religieusement deux films de deux cinéastes de catégorie 2:
Smoking/No smoking et
Le hasard. Message entendu. M. Van Dormael, votre
cinéma est malade, parce que pollué de recherche de positionnement de caméra, de lumière abstraite, de faux décors, bref d'une mise en scène qui cherche à donner du relief au cinéma, cet art du langage des images en mouvement. C'est surfait, pas assez désincarné et désossé de la fioriture américaine. Vos acteurs manquent de la rigidité habituelle des drames français qui évoquent les sentiments tout comme de l'écriture ampoulée qui convient à toute romance malheureuse évoquant des regrets. Révisez votre étalon en la matière :
Un conte de Noël. Comment osez-vous sous la houlette de maisons de productions francophones, dresser la terrible démonstration de l'instantanéité des moments de la vie, de manière si fragmentée et si déconstruite comme si la vie ne se voyait pas dans son ensemble, qu'elle ne pouvait être abordée sans montage et de manière holistique.
Quel est ce crime que celui de tenter de pervertir vos maîtres et compatriotes Jean-Pierre et Luc Dardennes, avec votre tentative de romance interdimensionnelle, alors qu'il n'y a qu'une dimension à rechercher : celle de "la vie à filmer". Vous devez renoncer au statut de cinéaste, comme celui d'artiste, c'est à dire renier l'implication personnelle, l'interprétation, la mise en scène. Vous devez faire de la mise en situation, et montrez à tous que la caméra et le cinéaste doivent disparaître pour montrer les sujets que personne n'a jamais vus.
Revenez dans le giron comme l'a fait un autre réalisateur américain qui a voulu abordé un thème similaire dans son
The Fountain. Il n'y a pas d'élucubrations fantastiques dans la romance et l'introspection d'aujourd'hui. C'est bien connu, l'art du
faux est celui de la publicité, pas celui des cinéastes.
Le cinéma francophone n'a pas de privilège à discuter du temps et d'associer la relativité de l'existence humaine avec le parcours sentimental d'un homme ordinaire. Pourquoi utiliser l'amour comme point d'ancrage à votre réflexion sur le temps si ce n'est pour toucher les spectateurs dans leur condition d'homme et de femme, tout âge et race confondus.
Non décidemment, M. Van Dormael, vous accumulez les tares de tous ceux qui cherchent à faire du cinéma le véhicule d'émotions intentionnellement construites par un metteur en scène qui cherchent à communiquer avec son public. Votre travail participe au renforcement de l'idée même que le cinéma est affaire de fabrication, d'invention, de voyages, aussi loufoques, tourmentés et abstraits puissent-ils être.
Au nom de toute la critique traditionnellement reconnue dans ce pays, je souhaite que votre
sombre dans l'indifférence et l'anonymat qui sied parfaitement à votre personnage principal. Par ici la sortie (sic) ...






![abd-mother1080p[11-41-17]](http://img.over-blog.com/300x127/1/43/20/36/abd-mother1080p-11-41-17-.JPG)








![abd-mother1080p[12-12-27]](http://img.over-blog.com/300x127/1/43/20/36/abd-mother1080p-12-12-27-.JPG)
![abd-mother1080p[12-11-29]](http://img.over-blog.com/300x127/1/43/20/36/abd-mother1080p-12-11-29-.JPG)
![abd-mother1080p[12-11-52]](http://img.over-blog.com/300x127/1/43/20/36/abd-mother1080p-12-11-52-.JPG)
![abd-mother1080p[12-12-10]](http://img.over-blog.com/300x127/1/43/20/36/abd-mother1080p-12-12-10-.JPG)
![abd-mother1080p[12-12-23]](http://img.over-blog.com/300x127/1/43/20/36/abd-mother1080p-12-12-23-.JPG)





![abd-mother1080p[12-30-34]](http://img.over-blog.com/277x117/1/43/20/36/abd-mother1080p-12-30-34-.JPG)
![abd-mother1080p[12-31-20]](http://img.over-blog.com/277x117/1/43/20/36/abd-mother1080p-12-31-20-.JPG)
![abd-mother1080p[12-31-27]](http://img.over-blog.com/277x117/1/43/20/36/abd-mother1080p-12-31-27-.JPG)
![abd-mother1080p[12-31-33]](http://img.over-blog.com/277x117/1/43/20/36/abd-mother1080p-12-31-33-.JPG)
![abd-mother1080p[12-31-39]](http://img.over-blog.com/277x117/1/43/20/36/abd-mother1080p-12-31-39-.JPG)




 Chaque année, il y a des films injustement boudés, méprisés ou tout simplement ignorés par le public. Si cette indifférence a souvent un lien avec la qualité intrinsèque du film, la notoriété d'un film repose malheureusement sur la communication journalistique.
Chaque année, il y a des films injustement boudés, méprisés ou tout simplement ignorés par le public. Si cette indifférence a souvent un lien avec la qualité intrinsèque du film, la notoriété d'un film repose malheureusement sur la communication journalistique.

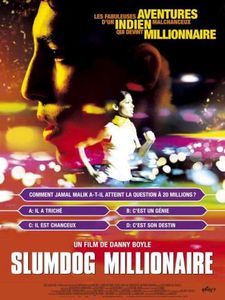


 4. Panique au village
4. Panique au village  5. District 9
5. District 9  6. Mary et Max
6. Mary et Max 
 8. Les noces rebelles
8. Les noces rebelles  9. Là-haut
9. Là-haut 10.
10.